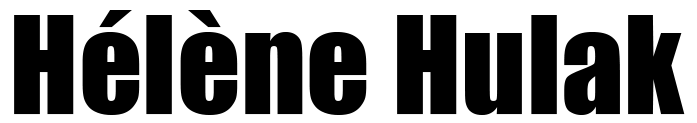2025
Peinture : Pigments liquides et acrylique, 450x280
Sculpture 1 : Textile, broderie et molleton sur étendoir à linge modifié, 100x68x200
Sculpture 2 : Textile, broderie et molleton sur étendoir à linge modifié, 140x68x310
Sculpture 1 : Textile, broderie et molleton sur étendoir à linge modifié, 100x68x200
Sculpture 2 : Textile, broderie et molleton sur étendoir à linge modifié, 140x68x310
Installation composée d'une peinture murale et de deux sculptures molles sur étendoirs à linge.
Interrogée sur de possibles filiations, Hélène Hulak évoque certaines affinités avec les sculptures d’Eva Hesse qu'elle considère comme une source d’inspiration. Avec ses « sculptures textiles étendoirs à linge » molles, composées de volumes suspendus, gonflés et irréguliers, elle produit des œuvres qui viennent volontiers à la rencontre des spectateur·rices quand elles ne tentent pas de les avaler. En concevant des environnements généreux, débordants et colorés, composés de figures de carnaval, de sorcières et d’épouvantails et des peintures murales à la palette dissonante et surprenante, on décèle un lien fort à certaines traditions de la culture populaire. Mais loin de se situer dans le populaire du pop-art — qui détournait, dans les années 60, la culture de la consommation pour mieux célébrer la « société du spectacle » —, c’est plutôt dans la lignée de Dorothy Iannone, de Kiki Kogelnik ou de Moki Cherry qu’elle inscrit son esthétique autant que ses convictions. Elle estime, en effet, que « contrairement à de nombreuses idées reçues, on peut être pop et féministe », l'approche étant celle d'« utiliser les outils de l’ennemi. »
Au lieu de situer son travail dans une démarche réflexive sur l’art, qui ne s'adresserait qu'à une minorité privilégiée, le pop d’Hélène Hulak s’appuie sur un registre emprunté au domaine de la publicité. Prélever ces images séduisantes, colorées et brillantes dans les médias de masse, ne relève pas de l’hommage et encore moins de la fascination, mais bien d’une stratégie. Il ne reste alors plus qu’à les détourner en en exacerbant les formes et les couleurs, de manière à créer un sentiment de déjà-vu capable de flirter avec une « inquiétante étrangeté ». Cette référence au concept du Unheimliche de Sigmud Freud n’est pas une provocation mais un détournement, permettant aux œuvres de se retourner contre celles et ceux qui les observent. L'artiste peut ainsi, par cette méthode, infiltrer l’inconscient avec des sujets engagés qui lui sont chers, comme le féminisme.
C’est ainsi que ses recherches actuelles l’ont amenée à s’intéresser à des lieux intimes tels que la salle de bain. Espace privé, haut lieu de la nudité et du soin, il est fréquemment exploité dans l’univers du cinéma, de la télévision et de la presse pour proposer le corps de la femme — et de l’homme — en appât aux consommateur·rices. Ce paradoxe de l’intimité, livrée en pâture à l’œil intrusif, est renforcé par les publicités qui tournent en boucle pour célébrer les shampoings, les soins pour la peau, et tous ces produits vendus pour être toujours plus séduisant·es, plus jeunes et plus heureux·ses. Le travail d’Hélène Hulak prend ainsi la forme d’une scène ou d’un plateau de cinéma où serait filmée une séquence, ce qui lui permet d'interroger les modes d’implication des spectateur·rices, tout en suscitant un questionnement méthodique de la mobilisation du corps et du regard.
Au cinéma, Hélène Hulak remarque que la salle de bain est le lieu privilégié des assassinats, comme si « l'imaginaire du plaisir buggait à cet endroit-là ». C’est précisément dans cette familiarité dérangeante que l’artiste cherche à provoquer ce bug ou ce glitch et, par là même, le déclic du questionnement.
Interrogée sur de possibles filiations, Hélène Hulak évoque certaines affinités avec les sculptures d’Eva Hesse qu'elle considère comme une source d’inspiration. Avec ses « sculptures textiles étendoirs à linge » molles, composées de volumes suspendus, gonflés et irréguliers, elle produit des œuvres qui viennent volontiers à la rencontre des spectateur·rices quand elles ne tentent pas de les avaler. En concevant des environnements généreux, débordants et colorés, composés de figures de carnaval, de sorcières et d’épouvantails et des peintures murales à la palette dissonante et surprenante, on décèle un lien fort à certaines traditions de la culture populaire. Mais loin de se situer dans le populaire du pop-art — qui détournait, dans les années 60, la culture de la consommation pour mieux célébrer la « société du spectacle » —, c’est plutôt dans la lignée de Dorothy Iannone, de Kiki Kogelnik ou de Moki Cherry qu’elle inscrit son esthétique autant que ses convictions. Elle estime, en effet, que « contrairement à de nombreuses idées reçues, on peut être pop et féministe », l'approche étant celle d'« utiliser les outils de l’ennemi. »
Au lieu de situer son travail dans une démarche réflexive sur l’art, qui ne s'adresserait qu'à une minorité privilégiée, le pop d’Hélène Hulak s’appuie sur un registre emprunté au domaine de la publicité. Prélever ces images séduisantes, colorées et brillantes dans les médias de masse, ne relève pas de l’hommage et encore moins de la fascination, mais bien d’une stratégie. Il ne reste alors plus qu’à les détourner en en exacerbant les formes et les couleurs, de manière à créer un sentiment de déjà-vu capable de flirter avec une « inquiétante étrangeté ». Cette référence au concept du Unheimliche de Sigmud Freud n’est pas une provocation mais un détournement, permettant aux œuvres de se retourner contre celles et ceux qui les observent. L'artiste peut ainsi, par cette méthode, infiltrer l’inconscient avec des sujets engagés qui lui sont chers, comme le féminisme.
C’est ainsi que ses recherches actuelles l’ont amenée à s’intéresser à des lieux intimes tels que la salle de bain. Espace privé, haut lieu de la nudité et du soin, il est fréquemment exploité dans l’univers du cinéma, de la télévision et de la presse pour proposer le corps de la femme — et de l’homme — en appât aux consommateur·rices. Ce paradoxe de l’intimité, livrée en pâture à l’œil intrusif, est renforcé par les publicités qui tournent en boucle pour célébrer les shampoings, les soins pour la peau, et tous ces produits vendus pour être toujours plus séduisant·es, plus jeunes et plus heureux·ses. Le travail d’Hélène Hulak prend ainsi la forme d’une scène ou d’un plateau de cinéma où serait filmée une séquence, ce qui lui permet d'interroger les modes d’implication des spectateur·rices, tout en suscitant un questionnement méthodique de la mobilisation du corps et du regard.
Au cinéma, Hélène Hulak remarque que la salle de bain est le lieu privilégié des assassinats, comme si « l'imaginaire du plaisir buggait à cet endroit-là ». C’est précisément dans cette familiarité dérangeante que l’artiste cherche à provoquer ce bug ou ce glitch et, par là même, le déclic du questionnement.